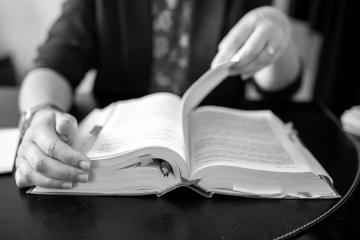Le 8 juillet 2025, au cours du Festival d’Avignon, Thalie Santé a organisé une table ronde consacrée à la prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels au travail (VHSST)*. En tant que service de prévention et de santé au travail de référence pour les industries culturelles et créatives, Thalie Santé a souhaité créer un espace d’échanges réunissant un panel d’acteurs du spectacle vivant, du droit, de la santé au travail et de la société civile pour parler de ce sujet.
Focus sur les principaux messages tirés de ces échanges.

Le contexte des VHSST dans le spectacle
Cet événement s’inscrivait à la fois dans une dynamique sectorielle de prise de conscience des enjeux liés à la lutte contre les violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), et une forte préoccupation autour de la santé mentale, déclarée grande cause nationale pour l’année 2025.
Fort de sa mission – prévenir les risques professionnels, soutenir les employeurs et accompagner chaque travailleur vers un environnement plus sûr et respectueux – Thalie Santé a souhaité à travers cette table ronde : poser des définitions claires, rappeler les obligations des employeurs, mais aussi donner la parole à des témoins, des associations et des professionnels de terrain afin de dresser un état des lieux des difficultés rencontrées et de proposer des leviers d’action concrets.
Le secteur culturel, et en particulier le spectacle vivant, présente un terrain d’exposition aux VHSST particulièrement propice : précarité des emplois, contrats courts, multiplicité des employeurs… Ces caractéristiques rendent la prévention indispensable mais aussi complexe, tant les rapports de force et les zones grises juridiques y sont fréquents. Au-delà de la description des risques, la table ronde a insisté sur la nécessité d’une approche collective, impliquant à la fois les employeurs, les salariés, les syndicats, la médecine du travail et les institutions publiques.
Comprendre les violences et harcèlement sexistes et sexuels
Sur le plan juridique, les VHSS recouvrent des réalités multiples, raison pour laquelle il est nécessaire de rappeler les définitions essentielles.
L’outrage sexiste et sexuel, inscrit dans la loi en 2018, vise à sanctionner les comportements intrusifs tels que le harcèlement de rue.
Le harcèlement sexuel, reconnu par la loi depuis 1992 et révisé en 2008, ne nécessite plus un rapport hiérarchique pour être caractérisé. Il peut consister en une pression grave, même isolée, visant à obtenir une faveur sexuelle, ou en des propos répétés qui portent atteinte à la dignité.
Les agressions sexuelles regroupent quant à elles les attouchements, les tentatives de viol et le viol, sanctionnés pénalement par des peines lourdes. L'envoi d'un nude pourra également, en fonction du contexte, caractériser une agression sexuelle comme d'autres situations qui n'impliquent pas un contact physique.
Enfin, les agissements sexistes, intégrés au Code du travail en 2015, désignent le sexisme du quotidien, souvent banalisé : remarques sur la tenue vestimentaire, attitudes condescendantes, blagues dévalorisantes.
Au-delà de ces définitions, un concept récent retient l’attention : le harcèlement d’ambiance. Il désigne un climat délétère où des blagues, attitudes et propos sexistes créent un environnement de travail toxique, même sans auteur identifié. Cette forme insidieuse de harcèlement illustre combien les violences sexistes et sexuelles peuvent être systémiques, alimentées par la culture de travail elle-même. Touchant l’ensemble d’un collectif de travail, cette dimension doit par conséquent être intégrée dans les actions de prévention.
Des constats partagés
La table ronde a mis en évidence la vulnérabilité du secteur du spectacle vivant. D’abord, la petite taille des entreprises et l’absence fréquente de Comité Social et Economique (CSE) empêchent souvent la mise en place de référents dédiés.
Ensuite, la brièveté des contrats et l’intermittence rendent difficile l’application du droit disciplinaire. De nombreux salariés évoluent dans des situations de coactivité, avec plusieurs employeurs impliqués sur un même projet : la dilution des responsabilités rend alors les signalements complexes et les prises en charge hésitantes.
La porosité entre vie privée et professionnelle est également remarquée : répétitions tardives, tournées, dîners professionnels, résidences artistiques… Autant de contextes où les frontières s’effacent et où les risques de comportements déplacés augmentent.
Par ailleurs, les artistes dépendent fortement du regard des metteurs en scène et directeurs artistiques, ce qui crée des rapports de pouvoir déséquilibrés. Nombreux sont ceux qui n’osent pas dénoncer de peur d’être mis de côté. Les témoignages rappellent les conséquences possibles : isolement, perte d’emploi, troubles psychologiques graves. Pour certaines victimes, le retour au travail devient impossible sans un accompagnement spécialisé.
Des outils et des dispositifs déjà en place
Face à ces constats, plusieurs dispositifs ont été mis en place ces dernières années. Les accords de branche du spectacle vivant intègrent désormais des clauses spécifiques pour lutter contre les VHSST, avec des boîtes à outils destinées aux petites structures.
Autre mesure, la désignation de référents VHSST est obligatoire au sein des CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés, et par la direction dans celles de plus de 250 salariés.
Une cellule d’écoute nationale, ouverte en 2021 par le groupe Audiens, propose un appui psychologique et juridique accessible à tous les professionnels du secteur, permanents ou intermittents. Depuis 2025, elle offre également une aide juridique financière au dépôt de plainte, sans condition de ressources.
Les syndicats, de leur côté, organisent des formations gratuites dont certaines sont même obligatoires : pour bénéficier de subventions publiques, pour obtenir le label Qualiopi dans les organismes de formation, ou encore dans les cursus d’écoles de comédiens et techniciens. Ces formations visent à diffuser une culture de prévention et à outiller tous les acteurs, du dirigeant au salarié, en passant par les managers et référents.
Enfin, certaines structures expérimentent la présence de coordinateurs d’intimité lors des scènes sensibles, une initiative qui pourrait être mutualisée dans le spectacle vivant.
Des pistes de prévention : agir à tous les niveaux
Les échanges ont permis d’identifier des leviers d’action prioritaires. La formation, d’abord, est considérée comme la pierre angulaire de la prévention. Elle doit commencer dès les écoles et se poursuivre tout au long des carrières, afin de modifier en profondeur les mentalités. Les situations à risque – castings, scènes d’intimité, événements festifs liés au travail – doivent être sécurisées grâce à des protocoles clairs.
La parité dans les postes de direction a elle aussi été soulignée comme un facteur clé pour réduire les rapports de domination structurels.
Lorsqu’un signalement survient, des mesures provisoires doivent être prises immédiatement : éloigner les protagonistes, adapter l’organisation du travail, rappeler les différents interlocuteurs tels que le médecin du travail et la cellule d’écoute d’Audiens.
L’accompagnement des victimes est sans aucun doute central : suivi psychologique, conseil juridique, aide au maintien dans l’emploi. Thalie Santé, à travers ses équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, assistants sociaux), joue ici un rôle déterminant. Pour certains, une reconversion professionnelle est nécessaire : le pôle maintien en emploi de Thalie Santé entre alors en action avec ses nombreux partenaires, tels que l’Afdas, pour par exemple initier des bilans de compétences et accompagner ces transitions.
Conclusion : un engagement collectif nécessaire
Les violences et harcèlement sexistes et sexuels au travail sont le produit de structures sociales et professionnelles qu’il est possible de transformer. La table ronde qui s’est déroulée à Avignon a montré qu’une prévention efficace passe par la conjugaison d’actions juridiques, pédagogiques, organisationnelles et culturelles. Les entreprises, les institutions et les professionnels doivent agir de concert pour instaurer des environnements de travail respectueux et protecteurs.
Dans ce cadre, Thalie Santé poursuit son accompagnement auprès de ses entreprises adhérentes et des publics qu’il suit, pour que la culture professionnelle change durablement. Au-delà du respect de la loi, il s’agit d’un enjeu de dignité, de santé et de justice pour tous les travailleurs et travailleuses des industries culturelles et créatives.
Comment Thalie Santé peut intervenir :
- Repérer les signaux de souffrance et accompagner les salariés lors des visites de suivi en santé au travail (accompagnement psychologique, social, maintien dans l’emploi …).
- Intervenir directement dans les structures pour sensibiliser les équipes.
- Clarifier les obligations légales en matière de prévention.
- Conseiller les employeurs face à des situations délicates.
- Aider à mettre à jour le DUERP.
- Recueillir un signalement ou un témoignage via sa boîte mail preventionvhss@thalie-sante.org
* Table ronde du 8 juillet 2025
Organisée au Cloître St Louis durant le Festival d’Avignon sur le thème "Prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels", cette table ronde a réuni Cédric Dalmasso, directeur du CGS, Mine Paris-PSL (modérateur) - Isabelle Ecckhout, directrice générale, Alice Bodin, responsable des infirmier(e)s en santé au travail et coordinatrice des VHSS, et Thomas Demaret, directeur pluridisciplinaire, pour l'équipe Thalie Santé - Ainsi qu'Emmanuelle Dancourt, journaliste et présidente de MeTooMedia, Guillaume Collet, responsable des affaires juridiques chez Ekhoscènes, Xavier Schmitt, délégué juridique au Syndicat Français des Artistes-interprètes (SFA CGT), Frédéric Danneker, juriste en Droit social, et Véronique Felenbok, co-présidente de Lapas.
Retrouvez l'enregistrement audio de la table ronde en ligne : https://www.artcena.fr/artcena-replay/lutte-contre-les-vhss